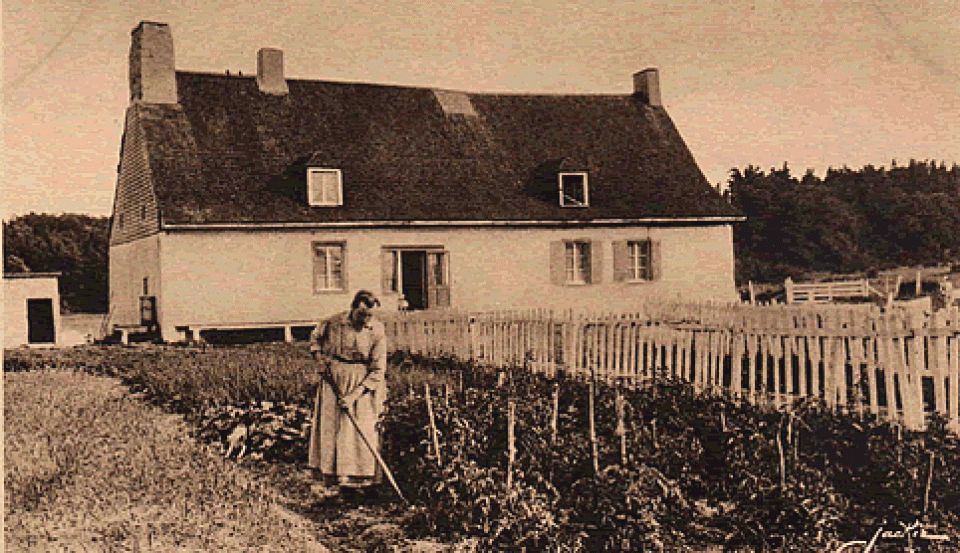Pour les trois prochaines semaines, mon attention se dirigera du côté de l’Acadie.
En effet, plusieurs de nos variétés québécoises ancestrales possèdent une génétique issue de cette contrée non seulement à cause des échanges (commerciaux et familiaux) mais aussi dû à la grande déportation proclamée par le Conseil de la Nouvelle-Écosse, le 28 juillet 1755.

Norbert Robichaud en train de préparer des ognons sous la supervision du chien Benny 2017 (photo: Norbert Robichaud)
De fait, la prise de possession par les Britanniques des colonies françaises en Amérique du Nord a forcé plusieurs à s’établir, entre autre, en Nouvelle-France, amenant avec eux leurs semences et leurs habitudes de culture. Avant cette déportation, il convient de souligner qu’ils avaient dès 1604 établi leur colonie à Port-Royal aux côtés de leurs alliés et amis autochtones, les Mi’kmaq; eux aussi possédant leurs propres semences depuis des générations. Des échanges ayant, avec le temps, aussi été faits entre eux. Avec une grande générosité, Monsieur Norbert Robichaud, grand protecteur de son terroir acadien, m’a fait parvenir trois textes concernant autant de cultivars inédits très rares. C’est avec une immense reconnaissance, photos à l’appui, qu’il me fait plaisir de vous retransmettre, avec son autorisation, le fruit de ses recherches et expérimentations, pour la postérité.
— texte de Norbert Robichaud —-
LES FAYOTS
Les fayots constituaient une part importante de l’alimentation de nos ancêtres « acadiens ». Les témoignages ne manquent pas chez les gens d’un certain âge qui affirment : « On mangeait des fayots à tous les jours pour déjeuner. » Une grande partie du jardin était réservée aux « fayots pour mûrir », ceux que l’on consommait en grain secs. Les cultivars que j’ai recueillis auprès des jardiniers de la région sont presque tous des haricots à grain sec, mais je me souviens que ma grand-mère paternelle conservait les semences de haricot mange-tout. Je me limiterai aux haricots à grain sec aux fins du présent article.
Il faut d’abord savoir que le haricot est une plante américaine, c’est-à-dire originaire d’une des deux Amériques. Les amérindiens de la vallée du Saint-Laurent le cultivaient à l’arrivée de Jacques Cartier. Celui-ci écrira à propos des indiens de Gaspé, dans son voyage de 1534 : « Ils ont aussi […] des fèves, qu’ils nomment sahe, les noix caheya, les figues honnesta, les pommes… »1. La présence du haricot au Nouveau-Brunswick est vraisemblablement due aux efforts de colonisation européens, car les amérindiens des maritimes n’étaient pas des agriculteurs. Néanmoins, en raison de ses origines américaines, il est possible que certains cultivars de notre région soient très anciens.
Précisons enfin que les haricots, ou les fayots, que nous retrouvons traditionnellement dans notre région sont issus de deux espèces différentes qui ne se croisent pas. Il y a le haricot commun (Phaseolus vulgaris), de loin de plus répandu, et le haricot d’Espagne (Phaseolus coccineus, synonyme multiflorus) que beaucoup connaissent sous le nom de Scarlet Runners, beaucoup plus rares.
LE FAYOT VIEUX FLIPPE

Graines de fayot Vieux Flippe (image: Norbert Robichaud, 2018)
Dans les années 2009-2010, j’ai commencé à m’intéresser à la conservation des semences anciennes. Je suis allé voir des amis jardiniers qui conservaient certaines semences. Une de ces variétés est les fayots du « Vieux Flippe ». C’est la mère de Thérèse Robichaud qui le cultivait depuis les années 1940 et qui l’avait obtenu de Mme Mabel Comeau de Nigâwêk qui les tenaient de son père, Philippe Landry. Ce dernier était désigné familièrement sous le nom de « Vieux Flippe », d’où le nom donné au haricot. Personne ne semble savoir de qui Philippe Landry aurait obtenu ce cultivar ni en quelle année.

Cosses de fayot grimpant Vieux Flippe (image: Norbert Robichaud, 2018)
Malgré toutes les recherches que j’ai faites auprès de différentes banques ou maisons de semences, je n’ai jamais réussi à trouver un cultivar qui possède l’ensemble des caractéristiques du « Vieux Flippe ». Il pourrait de ce fait s’agir d’une variété unique et très ancienne. La première caractéristique qui témoignerait de son ancienneté est qu’il s’agit d’un haricot grimpant. Il faut savoir qu’originalement, le haricot est une plante grimpante et que le haricot nain, qui est maintenant cultivé partout, provient d’une mutation. Autre caractéristique d’une espèce ancienne, elle pousse et mûrit rapidement. Elle est donc adaptée à notre climat, ce qui suggérerait une présence de longue date en climat nordique.

Fayot grimpant en fleurs Vieux Flippe (image: Norbert Robichaud, 2018)
Ce haricot est apparenté aux haricots « Cranberry ». Il se présente sous deux formes, l’une aux grains marbrés de rouge et relativement petits, l’autre aux grains marbrés de violet et nettement plus grosse. Les deux formes produisent des feuilles comportant jusqu’à cinq folioles dans les feuilles les plus basses et chez les deux formes, on retrouve occasionnellement des grains dont la couleur s’étend à la quasi-totalité du grain contrairement aux marbrures habituelles. Les deux variantes sont cultivées côte-à-côte comme s’il s’agissait d’une seule espèce et je l’ai toujours offert de cette façon, telle que je l’ai découverte. Ce cultivar a fait l’objet d’une adoption dans le cadre du Programme semencier du Canada.

Fayot grimpant Vieux Flippe à maturité (image): Norbert Robichaud, 2018)
TOUTE REPRODUCTION DES TEXTES ET PHOTOGRAPHIES EST INTERDITE SANS LE CONSENTEMENT DE MONSIEUR NORBERT ROBICHAUD.