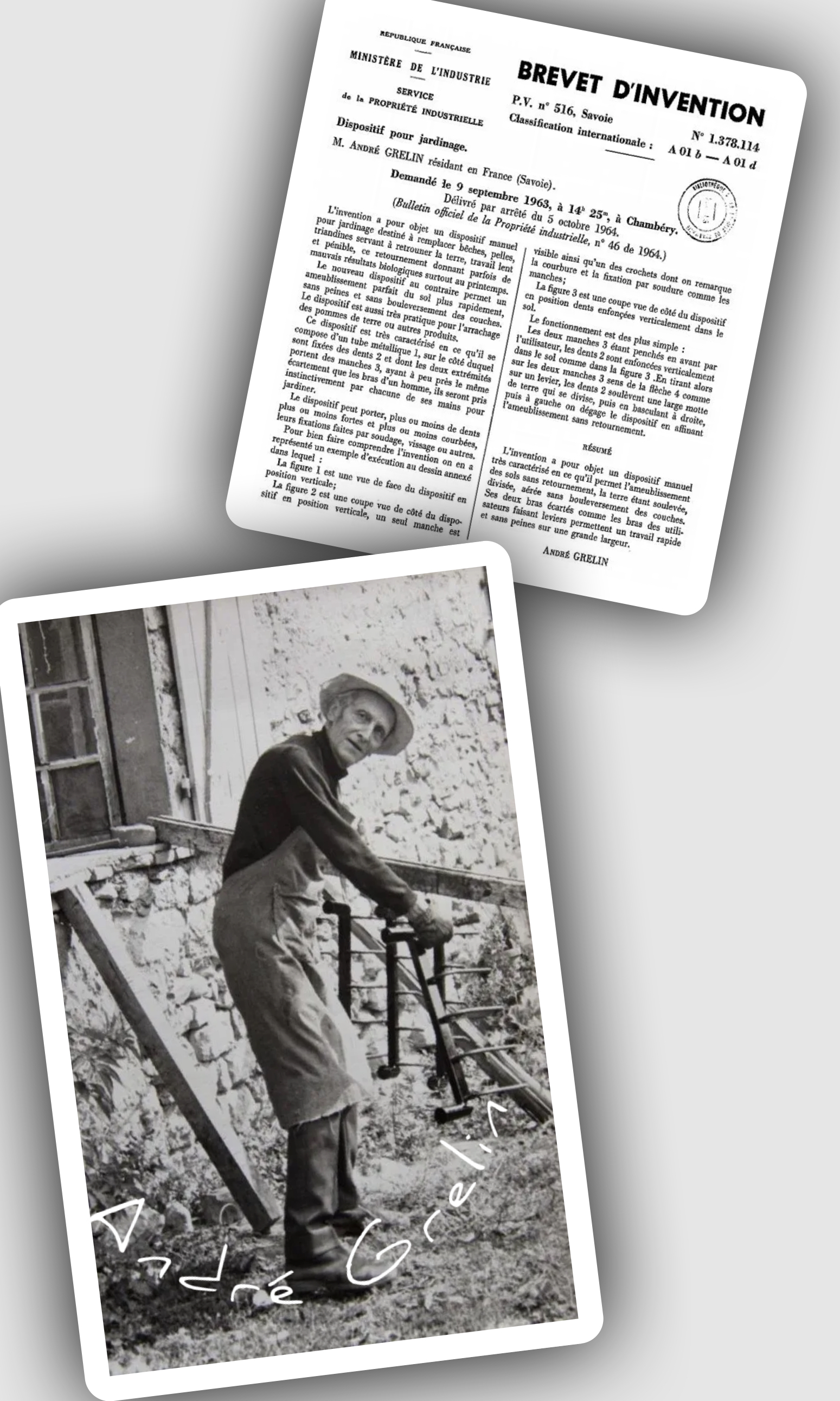Je peux me vanter de posséder encore la première version du livre de Yves Gagnon intitulé « Introduction au jardinage écologique ». Éditée en 1984, on est loin des belles publications modernes avec images et pages glacées mais outre l’aspect visuel, le contenu intéresse davantage.

En effet, déjà il exposait ses observations et expérimentations vécues depuis son adolescence au sujet de la santé du sol et des plantes, la planification du potager, la pratique du jardinage et finalement la conservation des aliments. Il y allait même de commentaires incisifs destinés au monde de l’agroalimentaires et de leurs conséquences sur notre santé et l’environnement. Avant d’écrire sur une personne significative dans le monde de l’horticulture ou de l’agriculture, je m’intéresse au déclic ayant produit l’étincelle qui allait la propulser vers son chemin de vie, sa vocation. La prise de conscience de Yves Gagnon ressemble tellement à celle qu’on vit collectivement aujourd’hui; un visionnaire pour l’époque. Je vous écris un passage de cet éveil tiré de l’ouvrage. L’histoire remonte aux années 1950 après qu’il ait travaillé (des semences à la récolte) dans une ferme de fruits et légumes en Colombie-Britannique pendant 5 saisons. Il fût ainsi un témoin privilégié des changements à venir. Il décrit:
… à cette époque, les producteurs n’avaient pas beaucoup de problèmes avec les insectes, l’équilibre écologique était intact et dès que se manifestait une épidémie d’insectes, la plupart du temps, des prédateurs apparaissaient comme par magie, l’enrayant rapidement. Tous les étés, se tissaient des cocons de chenilles dans les branches de certains arbres. La situation n’était jamais dramatique mais le cultivateur devait couper ces branches et les brûler.
Un jour, un agent vendeur de produits chimiques vint voir les cultivateurs et leur proposa de sauver du temps en vaporisant un insecticide dans les arbres pour tuer les chenilles. Comme les cultivateurs devaient passer quatre à cinq jours par été dans les vergers à couper les branches infestées, la proposition de l’agent leur sourit; ils achetèrent le produit suggéré et le vaporisèrent dans leurs vergers. Comme par magie, les chenilles moururent…. ainsi que d’autres insectes … et des oiseaux.
Quelques années passèrent et le scénario se répéta jusqu’à ce qu’une variété d’insectes commence à se développer très rapidement; ces insectes faisaient beaucoup de tort aux nouvelles pousses. Notre agent de produits chimiques revint avec un autre produit qui enraya immédiatement le problème. Le temps passa… et un papillon devint très résistant à ce nouvel insecticide; il abimait les pommes. On dut augmenter les doses de poison et accentuer les fréquences de vaporisation. À cette époque, on commençait déjà à utiliser les engrais chimiques afin d’augmenter la production. Avec les années, comme le sol s’appauvrissait, les arbres s’affaiblirent et devinrent malades.
On introduisit alors les fongicides, puis les herbicides, d’autres insecticides et puis finalement des hormones de tous genres. Aujourd’hui, certains vaporisent leurs vergers plus de 30 fois avec au moins 10 produits différents. Mais les arbres s’en portent-ils mieux? La réponse bien sûr est négative! Les arbres sont tous malades; leurs feuilles sont jaunâtres en plein été; les pommes sont fragiles et les insectes de plus en plus nombreux et résistants. Où cela nous mènera-t-il?
37 ans plus tard… Où cela nous a-t-il mené? Ça ne vous rappelle pas l’histoire récente de l’agronome lanceur d’alertes Louis Robert? Ce qui me renverse dans cette publication consiste aux thèmes qui font encore davantage de sens aujourd’hui tels l’agriculture intensive sur petites surfaces, les amendements, le séchage naturel, la culture biologique, etc. Y’a pas à dire, beaucoup de réponses à nos problèmes agricoles actuels peuvent encore s’inspirer des anciens écrits.

Vous aimeriez connaître un peu mieux l’homme? Voici ici-bas un reportage du 28 novembre 2020 d’environ 10 minutes à l’émission « La semaine verte ». Vous entendrez les propos de l’un des semenciers québécois précurseur de la sauvegarde du patrimoine génétique et de la culture biodiversifiée au Québec. C’est à lui qu’on doit notamment le sauvetage de la tomate Savignac.
Pour des versions plus récentes de ses oeuvres, consultez son site Internet. Sachez que je n’ai reçu aucun montant d’argent ni faveur pour cette suggestion.